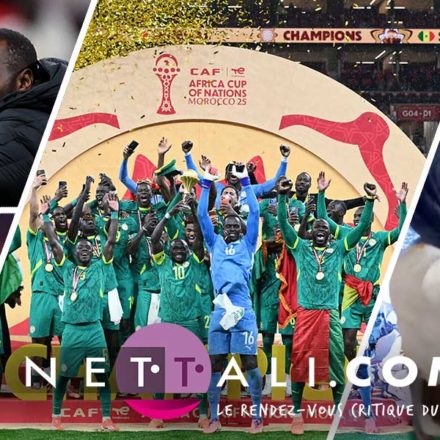NETTALI.COM - 381 supports non conformes au code de la presse du Sénégal. C’est du moins ce qui ressort de l’arrêté signé par le ministre de la Communication, Alioune Sall, en date du 22 avril 2025, sommant les organes de presse non conformes aux critères définis par la réglementation, de cesser toute diffusion ou tout partage de contenus, de supports, en application des dispositions du Code de la presse. Une situation inédite jamais connue sous nos cieux, mais tout aussi incompréhensible.
La conséquence, ce sont non seulement des destructions d’emplois, mais pire encore, une atteinte à la liberté d’expression.
Une régulation sujette à caution
Dans ce dossier de régulation, tout n'est pas aussi lisse qu'on veut le faire croire. Mais si l'on veut être honnête et se dire la vérité, si les autorités voulaient juste réguler le secteur, la méthode utilisée aurait pu être plus inclusive, avec des acteurs de la presse associés au processus, surtout que les acteurs de la presse ont eux-mêmes, lors des assises de la presse, à la veille de la fin second du mandat de Macky Sall, appelé de leurs vœux, un assainissement de leur secteur. Non pas toutefois de manière aussi autoritaire, mais plutôt en suivant une logique pédagogique et progressive, à même de permettre à ces médias recalés, de voir leurs capacités d’abord renforcées, avant de se mettre définitivement en règle.
Comment peut-on par exemple d’emblée fixer un nombre d’employés minimum à un médium comme si tous les médias avaient la même stratégie, les mêmes volumes et rythmes de production, ainsi que les mêmes capacités financières ? Tout cela veut simplement dire que l’on avait déjà préjugé du nombre d’employés capables de faire un travail dans une rédaction, alors que tout est une question d’organisation du travail, de volume de travail, de contenus et de niveau d’expérience des membres d’une rédaction. Le vice n’est nulle part ailleurs que dans le code de la presse qui est une loi votée par l’Assemblée nationale. Rappelons tout de même que lors du vote du code de la presse, il y avait de grosses divergences entre les députés et les acteurs de la presse sur la question de la dépénalisation des délits de presse.
Dans cette procédure de régulation polémique, ce qui a été d’autant plus incongru, c’est le critère de détention de la carte de presse qui devait être un critère essentiel et primordial et qui n’a pas été finalement pris en compte parce que l’Etat n’a pas octroyé les moyens financiers pour la tenue des sessions de la commission de validation des acquis de l’expérience depuis 2023 (l'année 2024 n'a pas été pourvue) à l’issue desquelles devaient être attribuées ou non les cartes de presse.
L’on aurait en effet appliqué le critère de détention de la carte de presse, que certains grands médias publics et privés n’auraient tout simplement pas été conformes.
Comment dès lors l’Etat, via le ministère de la communication, peut-il imposer aux médias d’être conformes, alors que lui-même ne s’est pas conformé à ses engagements en ne s’acquittant pas de ses obligations ? L’Etat de droit, eh bien, c’est un état dans lequel, les gouvernants sont eux-mêmes soumis au droit. Nos autorités doivent en effet être exemplaires si elles veulent que leur autorité soit reconnue.
Comment ne pas relever dans cette procédure de régulation, les erreurs notées lors de la publication de la liste des sites d’informations en ligne ? Le coup de gueule de Serigne Diagne de Dakaractu en disaient long sur l’oubli dont son support avait fait l’objet dans la liste. La suite est connue, il lui avait été notifié par la suite que son organe avait été bel et bien retenu. Tout comme d’autres médias en ligne qui avaient reçu la même notification. Que l’on veuille maintenant faire croire aux yeux de l’opinion, qu’il ne s’agissait nullement d’erreurs ou d’omissions…
Des rapports heurtés entre le régime actuel et la presse
En plus de cet écueil détention de la carte de la presse qui crée une contradiction majeure, il s’agit de noter que les gouvernants actuels n’ont jamais fait preuve de bienveillance à l’égard de la presse. Leur posture, que cela soit celle du Premier ministre Ousmane Sonko ou du président de la république (d’ailleurs Diomaye mooy Sonko, Sonko mooy Diomaye) n’a jusqu’ici été qu’hostilité, aussi bien avant leur accession au pouvoir, qu’à leur accession au pouvoir.
Le premier ministre, par exemple, n’a jamais cessé de dénigrer la presse, en traitant des journalistes de corrompus, en faisant publiquement des déclarations pas très sympa comme celle de n’avoir aucun compte à rendre à la presse ! Qui lui en demandait ? Tant qu’il passait par la presse pour livrer confortablement ses messages, aucun souci.
Tout comme le président de la république, Bassirou Diomaye n’a pas du tout été aimable vis-à-vis de la presse. Ne s’en était-il pas publiquement pris la presse en la descendant en direct, à la télévision publique, alors qu’il recevait les jeunes reporters. Rappelons d’ailleurs que la demande d’audience de ces mêmes patrons, n’a jamais connu de suite.
Et pourtant, si l’on n’a pas la mémoire courte, il est difficile de ne pas se rendre à l’évidence que certains médias, sortis de leur rôle de traitement de l’info, ont été des soutiens actifs du Pastef. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si quelques journalistes ont été nommés, une fois le Pastef au pouvoir, à des postes de directeurs généraux et de PCA, alors que certains d’entre eux ne maîtrisent aucunement les rudiments du management d’entreprise. Mais à la vérité, l'on sait bien que ce n’est nullement le rôle d’un journaliste que d’être pour ou contre un camp politique
Autre époque, autre réalité, les « chroniqueurs », jadis soutiens actifs de l’opposition Pastéfienne pour certains d’entre eux, ne sont plus les bienvenus dans l’univers médiatique, sur les web TV et les réseaux sociaux. Ils sont pourtant nombreux ces chroniqueurs qui ont soutenu le Pastef. L’un des plus connus et des plus en vue, est sans aucun doute Cheikh Bara Ndiaye. Passé de tradipraticien à « chroniqueur » et « analyste politique », il était adoubé par le peuple pastéfien et personne n’y avait trouvé à redire dans ce camp politique. Du fait de ce soutien, il s’est même retrouvé dans le liste de Pastef et est aujourd’hui devenu député. Il n’ y avait pas qu’eux puisque dans le lot, figuraient des activistes, des artistes, des rappeurs qui ont soutenu le Pastef à travers ces mêmes supports. Mais ironie de l’histoire, ce sont quelques-uns de ces mêmes acteurs qui critiquent actuellement sévèrement le régime en place : Karim Xrum Xak, Akhenaton, Mollah Morgan, des membres de Y’en a marre etc, pour ne citer que ceux-là. Il y’avait également dans le lot, des prêcheurs, de supposés juristes et écrivains dont on pouvait se poser des questions sur leur background.
Véritables empêcheurs de tourner en rond et très critiques avec le nouveau régime, certains d’entre eux font aujourd'hui le buzz sur les plateaux télé, internet et les réseaux sociaux et leurs sorties scrutées à la loupe. Récemment d’ailleurs Abdou Nguer l'un d'eux est placé en détention, dans une procédure d’instruction, inculpé pour diffusion de fausses nouvelles, pour avoir insinué que la mort du défunt président du Conseil Constitutionnel, Mamadou Badio Camara, ne serait pas naturelle et qu’il fallait faire une autopsie. De même, est évoquée une histoire de faux diplômes qui impliquerait Badara Gadiaga, autre "chroniqueur" très suivi après qu’avait été demandé un boycott de la TFM qui a d’ailleurs boosté l’audience de l’émission « Jakaralo ».
Il est certes vrai qu’on attend d’un chroniqueur (en dehors d’être un journaliste qualifié et reconnu dans un domaine précis) qu’il soit lui aussi (en tant que non journaliste), un spécialiste tout aussi reconnu dans le domaine où il intervient. Ce qui n’est pas le cas pour beaucoup et Abdou Nguer et Cie ne sont pas les seuls dans ce cas.
Les gouvernants actuels avec leur posture, donnent assurément l’image d’hommes politiques qui sont montés sur le toit après avoir arpenté les marches de l’échelle et qui ont décidé de balancer l’échelle pour qu’aucun autre politique n’accède au sommet, grâce à ces mêmes soutiens médiatiques et ces réseaux sociaux.
Ce que l’expérience nous a en tout cas suffisamment montré, c’est qu’aucun des régimes qui se sont succédés au pouvoir, n’a jusqu’ici montré un réel intérêt à voir des médias forts et indépendants, émerger. Le gouvernement actuel a, rappelons-le, suspendu les contrats des médias privés avec les entreprises publiques ainsi que le paiement des publicités déjà consommées. Ce, depuis plusieurs mois. Ce qui n’a toutefois pas empêché les supports de continuer à paraître et à diffuser leurs contenus.
La solution ne se trouve que dans un modèle économique repensé et viable
Si l’on veut voir émerger une presse plus indépendante et plus forte, la solution ne réside certainement pas dans le Fonds d’appui et de développement de la presse, allouée annuellement et dénommée de manière péjorative « aide à la presse ». Qu’on n’oublie tout de même pas que celle-ci est soumise à certains critères que sont, entre autres, la disposition d’un quitus fiscal, l’acquittement aux cotisations pour ses salariés à l’IPRES et à la sécurité sociale, le fait d’être constitué en entreprise, etc. Des critères à remplir et qui correspondent à des points qui vont déterminer le montant à percevoir. Ce qui veut dire que cette aide est loin d'être garantie.
Il est d’ailleurs bien étonnant de lire ou d’entendre des Sénégalais dans les réseaux sociaux ou certaines tribunes s’offusquer du fait que les médias perçoivent cette subvention ou aide. Beaucoup croient en fait qu’il s’agit d’un énorme pactole attribué aux médias. Or, ils ignorent que l’octroi des montants n’est pas aussi conséquent qu’ils le pensent. Celle-ci ne couvre même pas la moitié de la masse salariale mensuelle de certains supports. Cette même subvention est pourtant allouée aux Sénégalais dans leur transport public, leur nourriture, leur agriculture, leur électricité etc et personne ne trouve à y redire. Si ceux-là ignorent que la presse assure une mission de service public, il sera bien difficile de leur expliquer autre chose.
La solution pour l’autonomie financière des médias ne saurait donc nullement résider dans le fait d’augmenter ou pas, un Fonds d’appui et de développement de la presse de 1,9 à 2,7 milliards par an, surtout que l’on sait bien qu’il n’a pas été distribué en 2024. C’est ce qui a fait régir le Conseil des Diffuseurs et Editeurs de presse (Cdeps) qui, dans un communiqué datant du 4 mai, a fait savoir que, depuis sa prise de fonction, M. Alioune Sall n’a jamais procédé à la distribution du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) ou subvention à la presse, ajoutant qu’ en 2024, il a volontairement ralenti la procédure, entraînant le reversement du budget alloué au FADP au Trésor public.
Le Cdeps ne s’est pas arrêté là, puisqu’a-t-elle ajouté, « contrairement à ce que laisse entendre le directeur de la Communication, ce montant est loin d’être perdu. Une loi de finances rectificative peut permettre sa récupération »
Par ailleurs, ajoute le même communiqué "le ministère vient d’annoncer, en ce cinquième mois de l’année 2025, une réforme précipitée et unilatérale du décret portant sur le FADP, sans aucune concertation avec les professionnels du secteur. Cela, alors même que le CORED est en sommeil et que la Commission de la Carte nationale de Presse n’a pas délivré de cartes professionnelles depuis plus d’un an. Le ministère de la Communication semble se complaire dans les effets d’annonce, au détriment des véritables urgences du secteur "
Les bailleurs tels que la BAD et la Banque mondiale ont en tout cas eux bien compris l’enjeu que constituent des médias libres et indépendants dans une démocratie. Aussi, ont-ils, dès l’année 2023, entrepris un processus, en collaboration avec l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), pour "accompagner les entreprises de presse à se relever, mais surtout à se structurer, à être viables et être les modèles que le Sénégal attend dans ce qui est la liberté de la presse, mais aussi la transmission d’informations justes et véridiques". C’est ainsi qu’une subvention de 384 millions de francs CFA été octroyée à 12 entreprises de presse, dans le cadre du programme de restructuration financière des entreprises de presse, qui en est à sa phase pilote.
C’est pourquoi toujours dans ce communiqué datant du 4 mai, le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) s’est félicité de l’appui que l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a octroyé à douze (12) entreprises de presse le samedi 3 mai 2025, dans le cadre du Programme d’appui à l’accélération industrielle, à la compétitivité et à l’emploi (PAAICE) financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) depuis décembre 2021, à l'instar du programme ETER de la Banque mondiale. Cette subvention représente un véritable souffle de relance pour des entreprises en difficulté depuis près d’un an. Un financement de l’ADEPME qui entre dans le cadre de son portefeuille "Fonds à frais partagés" et porte sur 75% de la subvention totale. Chacune des 12 entreprises concernées devra libérer, selon l’article 3 de la Convention, sa quote-part de 25% avant d’accéder à l’allocation. Aucun fonds n'a pour l'heure été versé aux entreprises tant que les 25% ne sont pas mobilisés et consommés.
Le Cdeps a toutefois précisé qu’à aucun moment, le ministère de la Communication ne s’est impliqué dans le processus de cette initiative. Nous dénonçons avec fermeté cette tentative de récupération malveillante, motivée par la volonté manifeste de manipuler l’opinion et de discréditer les responsables d’entreprises de presse.
Toute cela témoigne de rapports très heurtés entre le ministère (qui a entrepris une réforme du secteur à marche forcée) et le Cdeps sont aujourd’hui devenus si tendus que l’on se demande si cette réforme sera vraiment efficace.
Si la presse veut rester forte et indépendante, les journalistes doivent s’évertuer à rester à leur place et se garder de toute accointance avec un quelconque bord politique, qui ne sera d’aucun apport sinon que de les instrumentaliser et les affaiblir. Qu’ils unissent donc un peu plus leurs forces et réfléchissent à un modèle économique plus viable, seul gage de leur indépendance.
Les régimes passent, mais les médias demeureront toujours. Les régimes qui ont compris cela, ont tout compris. Ceux qui ne l’ont pas compris, continueront à donner des coups d’épée dans l’eau car le pluralisme de la presse ne permet aucunement le contrôle des médias dans leur ensemble.