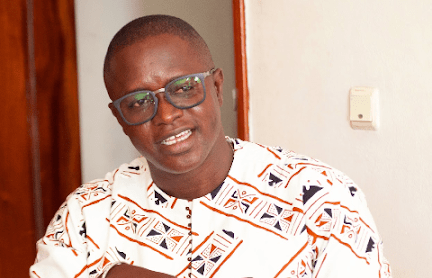CONTRIBUTION - En octobre 2025, Moody’s a abaissé la note souveraine du Sénégal de B3 à Caa1, assortie d’une perspective négative selon Dr Amath Ndiaye économiste. Derrière ce simple code alphanumérique se cache une onde de choc : hausse du coût de l’endettement, perte de confiance des investisseurs, et interrogations sur la trajectoire budgétaire d’un pays longtemps perçu comme modèle de stabilité en Afrique de l’Ouest. Mais au-delà du diagnostic économique, cette décision relance un débat fondamental : qui juge la crédibilité des États africains et selon quels critères ?
Une dégradation technique… mais à forte portée politique
Moody’s justifie sa décision par trois indicateurs inquiétants :
• un déficit budgétaire qui a grimpé à 14 % du PIB en 2024 (contre la norme de 3 % fixée par l’UEMOA) ;
• une dette publique atteignant 118,8 % du PIB ;
• une hausse du service de la dette absorbant près du quart des recettes fiscales ;
• et un retard dans l’adoption effective des mesures de redressement budgétaire, combiné à l’absence actuelle d’un accord formel et structuré avec le Fonds monétaire international.
Sur le papier, ces chiffres traduisent une perte de discipline budgétaire. Mais dans les faits, ils s’expliquent aussi par des investissements massifs dans les infrastructures et la transition énergétique, ainsi que par des effets post-pandémiques encore visibles.
Le paradoxe, c’est que cette même stratégie d’endettement, lorsqu’elle est menée par les États-Unis ou le Japon, est interprétée comme un levier de croissance ; tandis que pour le Sénégal, elle devient un signal de risque.
Deux poids, deux mesures : Sénégal, Grèce, États-Unis
Le contraste est frappant. Les États-Unis affichent aujourd’hui une dette publique équivalente à 125 % du PIB, supérieure à celle du Sénégal, tout en conservant une note Aa1 avec perspective stable. Pourquoi ?
Parce que Washington dispose du dollar, monnaie de réserve mondiale, et d’une crédibilité institutionnelle considérée comme inébranlable.
La Grèce, de son côté, a connu en 2009 une descente aux enfers après avoir falsifié ses chiffres budgétaires
— une faute que le Sénégal, lui, n’a jamais commise.
Les ajustements récents de Dakar résultent de la reconsolidation statistique de certaines dettes publiques et parapubliques.
Mais pour les agences de notation, la nuance importe peu : ce qui compte, c’est la perception du risque, et cette perception est rarement à l’avantage des économies africaines.
Les arbitres du crédit mondial
Comme le souligne l’économiste Dr Seydou Bocoum, la finance internationale fonctionne comme un écosystème hiérarchisé où cinq acteurs structurent la dépendance financière du Sud :
1. La Réserve fédérale américaine (FED), qui fixe le coût du crédit mondial.
2. Le FMI et la Banque mondiale, qui conditionnent l’accès aux devises.
3. Les agences de notation, qui traduisent des réalités économiques complexes en simples lettres.
4. Les banques d’investissement, qui transforment ces notations en produits financiers.
5. Les fonds d’investissement, qui profitent des primes de risque sur les dettes africaines.
Résultat : les pays africains sont souvent piégés dans une spirale de dépendance analytique.
Ils empruntent sur la base d’évaluations produites à New York ou à Londres, par des analystes rarement familiers des dynamiques locales.
Une réponse africaine : la souveraineté analytique
Face à cette asymétrie, la création en 2025 d’une Agence africaine de notation à Maurice marque un tournant. Son ambition : • intégrer les réalités africaines dans l’évaluation du risque ;
• réduire la prime d’injustice qui pèse sur les États du continent ;
• et bâtir une crédibilité financière endogène.
L’idée n’est pas de créer une bulle protectionniste, mais de redonner la parole aux économies africaines dans la construction de leur image financière.
Cette souveraineté analytique — la capacité à produire sa propre évaluation économique — est une étape clé vers une indépendance intellectuelle et financière durable.
Responsabilité budgétaire et justice financière
Soyons clairs : la critique des agences de notation ne doit pas servir d’alibi à l’indiscipline budgétaire.
Le Sénégal, comme d’autres pays, doit poursuivre ses efforts de transparence, de réduction du déficit, et de maîtrise de la dette.
Mais il est tout aussi légitime d’exiger que la justice financière mondiale repose sur des critères équitables et contextualisés.
Un pays ne devrait pas être pénalisé simplement parce qu’il ne dispose pas d’une monnaie de réserve ou d’un siège à Wall Street.
Il est temps que les évaluations de risque prennent en compte des indicateurs plus larges : résilience sociale, innovation, stabilité démocratique, intégration régionale.
Reprendre la main
La dégradation de Moody’s agit comme un électrochoc salutaire. Elle rappelle aux États africains que la souveraineté économique ne se décrète pas, elle se construit. Et qu’il est impossible d’être maître de son destin financier tant qu’on reste jugé par d’autres selon des standards exogènes. La souveraineté analytique n’est pas un luxe intellectuel — c’est un outil stratégique.
Reprendre la main sur la notation, c’est reprendre la main sur la narration. Et dans le monde économique, celui qui écrit le récit finit toujours par fixer la valeur.
DR IBRAHIMA POUYE Expert en Développement international