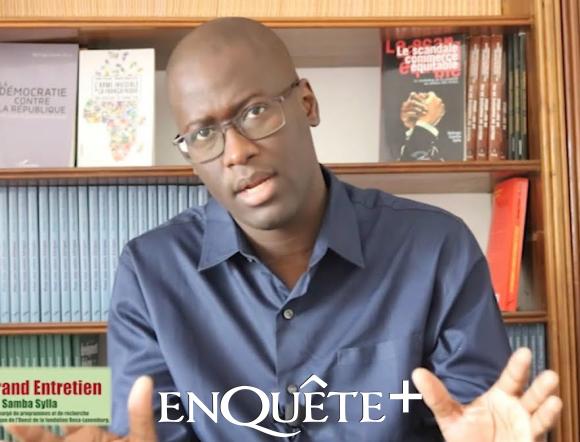GUEST EDITO - Le Plan de redressement économique et social, adossé à la Vision 2050, se veut l’expression d’un souffle retrouvé. Il signale l’ambition du nouveau pouvoir de sortir le pays de ses difficultés économiques actuelles dans l’optique d’asseoir les conditions d’un développement souverain et équitable. Issu de l’administration fiscale, le duo Faye- Sonko a promis de gérer les ressources publiques avec rigueur, dans la transparence et au bénéfice de l’intérêt général.
Cette quête vertueuse a cependant la particularité de s’inscrire dans le cadre intellectuel de la finance coloniale dont les économistes orthodoxes sont les champions. Ce cadre dicte ses lois dans le silence. Il étrangle l’imaginaire. Il fait taire l’audace. Il rétrograde l’État au rang de gestionnaire des contraintes : il faut partir en guerre contre les déficits publics au nom de la “rigueur budgétaire” et ne pas rêver trop grand. Les problèmes économiques tendent dès lors à être réduits à des enjeux comptables.
L’adhésion innocente du Plan de redressement et, plus généralement de l’administration sénégalaise, à cette vision conservatrice des finances publiques implique des choix économiques contestables voire extrêmement périlleux pour l’avenir du pays. Ce contre quoi nous voulons mettre en garde les autorités en place et l’opinion publique. Dans cet article, nous avons voulu interroger les fondements de ce cadre dominant, en éclairer les angles morts et suggérer un paradigme alternatif plus en phase avec les idéaux de souveraineté économique et de justice sociale.
Principes de la finance publique coloniale
Dans la période coloniale, les administrations qui géraient les territoires soumis n'avaient pas de souveraineté monétaire. Elles n'avaient pas leur propre banque centrale, c'est à dire une institution censée garantir leur indépendance financière dans les territoires sous leur juridiction. Elles avaient donc une contrainte financière objective. Leurs marges de manoeuvre étaient d'autant plus limitées que la politique de la métropole était de ne pas venir en aide aux colonies. Les administrations coloniales devaient financer elles-mêmes leurs propres dépenses sans avoir à espérer des concours de la métropole. C'est ce que l'on a appelé la finance gladstonienne, du nom d'un ancien Premier ministre britannique, partisan de cette vision. Ce paradigme est l'ancêtre de la finance néolibérale et des “critères de convergence” de l'UEMOA et de la CEDEAO.
Pour assurer leurs dépenses, notamment leurs salaires exorbitants alignés sur ceux de la métropole et leur fonctionnement, les administrations coloniales n'avaient pas le choix de ne pas prélever d'impôts et de taxes sur les populations qui étaient par ailleurs soumises au travail forcé. Les recettes douanières constituaient une autre source de revenus.
Les administrations coloniales faisaient donc de la “mobilisation des ressources domestiques”, au sens où l’on entend cette expression de nos jours : elles arrivaient à financer leurs dépenses sur la base de recettes internes. C'est ainsi que le colonialisme fut financé.
Entre 1833 et 1939, l’empire français n’a “coûté” à la France métropolitaine que 0,5 % de son revenu national en moyenne annuelle, sachant que les dépenses militaires ont représenté plus de 80 % de ces “transferts” (voir Denis Cogneau, Un Empire Bon Marché, 2023). Le cas du Congo “belge” est encore plus choquant. Il a été estimé que les retraites des travailleurs belges à la fin des années 1950 avaient représenté en valeur le double de ce que le Congo aura “coûté” à la Belgique durant toute la période coloniale.
La finance publique coloniale avait été un cadre propice pour les métropoles qui pouvaient gérer leurs empires sans coût budgétaire net tout en empochant des bénéfices économiques, notamment pour le capital privé métropolitain. Mais elle avait été destructrice pour les populations soumises. Pourquoi ?
Dans les faits, toute dépense financière équivaut à la création d’un revenu ; tout débit suppose un crédit et vice-versa. Tout modèle (ou plan) économique qui ne reconnaît pas que le solde budgétaire de l’État est l’inverse du solde financier du reste de l’économie ne peut qu’être erroné. C'est de la simple comptabilité. Si le gouvernement (colonial) dépense autant qu'il taxe, cela veut dire qu'il ne crée aucune richesse financière nette pour l'économie. Un solde budgétaire nul signifie que l'État n'a ni augmenté ni réduit la richesse financière des ménages et des entreprises considérés comme un ensemble macroéconomique (bien entendu, à un niveau microéconomique, certains ménages et entreprises se sont enrichis grâce à l'État tandis que d'autres se sont appauvris).
Parce que l'État colonial ne dépensait que ce qu'il recevait comme taxes et impôts, ou pire, enregistrait des surplus budgétaires, il en est résulté des déficits au plan réel, c’est à dire un sous-développement généralisé : analphabétisme, sousemploi, chômage, pauvreté de masse, etc.). Comme l'observait Samir Amin avec un brin d'humour : “en 1960, au Congo belge, il y avait neuf – pas dix ! – Congolais à peau noire qui avaient fait des études supérieures, six religieux et trois civils – je n’ai jamais su, ou j’ai oublié, s’ils étaient deux médecins et un avocat ou deux avocats et un médecin. Après trente ans d’un des plus odieux régimes de l’Afrique et du monde, celui de Mobutu, aujourd’hui, il n’y en a pas neuf, mais trois millions. Donc le pire régime a fait des milliers de fois mieux que la belle colonisation.”
Les administrateurs coloniaux belges avaient été des “modèles” en matière de “mobilisation de ressources financières domestiques” et de “responsabilité fiscale” : ils n’aimaient pas les “déficits publics” et ne dépensaient que ce qu’ils percevaient comme impôts et taxes.
De Julius Nyerere au Capitaine Ibrahima Traoré, en passant par Thomas Sankara et le duo Faye- Sonko, il a été extrêmement rare de voir des dirigeants africains progressistes remettre en question à la racine le paradigme de la finance publique coloniale. Leur combat pour les idéaux du panafricanisme et de la libération de l'Afrique a jusquelà pris pour argent compte ce que nos maîtres coloniaux nous ont appris en matière de finances publiques, et de finance plus généralement.
La vigueur insolente du cadre de la finance publique coloniale dans l'Afrique contemporaine fait sans doute partie des legs les plus durables et des accomplissements les plus spectaculaires du colonialisme européen en Afrique. C'est ce paradigme qu'on enseigne dans les universités et qui commande une quasiunanimité auprès des technocrates et des élites politiques, quelles que soient leurs différences idéologiques alléguées. C'est la matrice intellectuelle et institutionnelle des politiques de développement au niveau national aussi bien que des projets d'intégration économique, commerciale et monétaire.
De la finance fonctionnelle
À rebours de la finance coloniale, aujourd'hui confortablement emmitouflée dans le manteau du souverainisme et du panafricanisme, il existe un paradigme de finance publique scientifique et émancipateur : la finance fonctionnelle.
La finance fonctionnelle part du point de vue selon lequel l'État doit agir pour atteindre objectifs réels qui correspondent à l'intérêt général. À cette fin, il ne doit pas être contraint par des critères comptables définis a priori (comme les normes arbitraires de déficit et de dette publics fixés par le FMI, la CEDEAO et l'UEMOA).
Ce point de vue normatif s'ancre sur un fait scientifiquement incontestable mais ordinairement passé sous silence : les États modernes qui disposent de leur propre banque centrale n'ont pas de contrainte pour financer eux-mêmes tout ce qui s'achète dans leur propre monnaie. Les États qui disposent de leur propre banque centrale n'ont qu'une seule source de financement dans leur propre monnaie : la banque centrale elle-même. Le gouvernement dépense toujours via sa banque centrale qui crédite les comptes des banques pour faciliter les opérations de l'État. Chaque dépense de l'État augmente la masse monétaire tandis que les impôts et taxes réduisent celle-ci.
Comme l'État n'est pas financièrement contraint dans sa dépense, il doit avoir une approche fonctionnelle. Il doit prélever des impôts et taxes non pas pour se financer (car la Banque centrale peut toujours le faire directement ou indirectement) mais pour les objectifs suivants : lutter contre les inégalités, réguler la masse monétaire (éviter qu’un excès de demande suscite l’inflation) et affecter la structure des incitations (décourager certains comportements, produits et secteurs, en promouvoir d'autres). C’est ce que soulignait Beardsley Ruml, le président de la Réserve Fédérale de New York, dans un article de 1946 intitulé : “Taxes for revenue are obsolete” (“les impôts ne servent plus à financer l’État”).
À ceci, ajoutons une autre fonction importante de la fiscalité, notamment dans le cas des pays exportateurs de produits primaires et qui ont des monnaies périphériques : l’augmentation de la part de l’État dans les recettes d’exportation, et donc de la capacité nationale à financer les importations par les exportations. Dans le cas des secteurs extractifs, la fiscalité peut s’analyser comme un instrument de défense du taux de change, c’est-à-dire de la valeur externe de la monnaie.
Soulignons trois différences majeures entre la finance coloniale et la finance fonctionnelle. Tout d'abord, la finance fonctionnelle reconnaît que la nature de la monnaie est d’être une dette que l'État émet en vue de s'approvisionner en ressources réelles (terres, maind’oeuvre, matières premières, technologies, etc.). Ce n'est pas une marchandise. Elle ne peut donc jamais être rare. La contrainte qu'ont les États émetteurs de monnaie n'est pas de nature financière. Elle est de nature réelle : la capacité de dépense de l'État a pour limite l'inflation. Les États peuvent dépenser tant que les ressources réelles sont disponibles sur place et que cela ne suscite pas une hausse généralisée et permanente des prix. Et, justement, ils doivent avoir une dépense ciblée qui leur permettre d’élargir l’espace de dépense non-inflationniste et qui prenne en compte ses éventuelles répercussions sur la balance des paiements. Dans le cadre de ce paradigme, le rôle de l’État est d’abord et avant tout de mobiliser les ressources réelles : mettre en place des projets qui reposent sur et renforcent les ressources humaines, matérielles, techniques et organisationnelles disponibles (ou pouvant être créées) sur place. Cette approche diffère du concept habituel de “mobilisation des ressources domestiques”, lequel rime avec hausse de la collecte fiscale et recherche de “sources” de financements internes.
Ensuite, dans la finance fonctionnelle, l'impôt est un instrument indispensable et fondamental de régulation économique mais ne constitue en aucun cas une “source” de financement pour l'État émetteur de monnaie. Par contre, pour la finance coloniale, l'impôt est la condition de survie financière de l'État qui n'a pas de moyens autres pour assurer la permanence de son fonctionnement et de ses excès. Enfin, la finance fonctionnelle est orientée vers la satisfaction d'objectifs démocratiques et légitimes tandis que la finance coloniale a généralement la préférence des créanciers et des élites bureaucratiques.
Gare aux illusions !
Les impôts et taxes sont un prélèvement sur la richesse existante. Ils ne l'augmentent pas mais la redistribuent. Pour augmenter la richesse financière nationale, il y a deux robinets : le déficit public (avec une dépense publique et une fiscalité bien ciblées) et la création nette de crédits productifs par le système bancaire.
La transformation économique nécessite la mise en place d’un système financier national piloté par une banque centrale active et facilitant une politique rigoureuse de management du crédit. Joseph Schumpeter notait que le développement économique est un processus endogène qui requiert la figure centrale de l’entrepreneur qui lui-même a besoin du banquier, celui qui pourvoit le crédit, l’”éphore du système économique”, pour le citer. Son étudiant Hyman Minsky, sans doute l’un des économistes les plus féconds de la deuxième moitié du 21e siècle, observait de son côté que les innovations du secteur de la finance peuvent être déstabilisantes. C’est pourquoi les gouvernements qui souhaitent concilier transformation économique et stabilité financière doivent voir leur banque centrale jouer un rôle prépondérant, celui d’”éphore des éphores de la structure financière”.
Pour leur part, Samir Amin, Joseph Tchundjang Pouemi et Amady Aly Dieng ont montré, chacun de son côté, dans quelle mesure le sous-développement et l’extraversion des pays africains étaient facilités par les caractéristiques de leurs systèmes bancaires et financiers. Tous ces économistes avaient compris que c’est le système monétaro-financier qui commande la production dans le monde moderne. Tout le contraire de nombreux “experts” francophones habitués à débiter des absurdités telles : “la souveraineté monétaire ne sera pas une priorité tant que nous n’aurons pas des économies solides”.
Dans le cas des pays de l’UEMOA, le premier robinet – la création nette de crédits productifs - n’est ouvert que pour l’accumulation de type colonial. En effet, le système financier y est largement possédé par l'étranger. Il n'y a peu ou pas de banques publiques proprement dites. Les crédits bancaires sont majoritairement à court terme, peu orientés vers l'agriculture et l'industrie et sont très inégalement répartis. Au Sénégal, en 2024, plus d’un quart des crédits bancaires étaient captés par 50 entreprises, selon la BCEAO. Ces différentes caractéristiques ne sauraient surprendre. Une publication de la Banque mondiale évaluant les plans d’ajustement structurel au Sénégal notait en 1994 :
“La réforme du secteur bancaire – au cours de laquelle 7 des 15 banques du pays ont été fermées – doit être considérée comme la plus réussie. Cette réussite doit beaucoup au rôle très actif de la BCEAO, dont les conceptions en matière de restructuration bancaire étaient très proches de celles des bailleurs de fonds étrangers impliqués dans l’opération.” (M. Ranis, “Senegal : stabilisation, partial adjustment”, in I. Husain et R. Faruqee (dir.), Adjustment in Africa. Lessons from Country Case Studies,1994).
En raison de l'hégémonie du paradigme de la finance coloniale, le second robinet – les déficits publics - est généralement délégitimé par les décideurs politiques et leurs conseillers économiques toujours prompts à recommander le “retour à l’orthodoxie budgétaire” - faire trinquer les peuples sans toucher à leurs privilèges. La volonté de collecter vaille que vaille plus de recettes fiscales, l’obsession pour les niches fiscales, la cession désespérée (même temporaire) d’actifs publics, le haro inconsidéré sur les “déficits publics” etc. sont aux antipodes du paradigme de la finance fonctionnelle. Ce type de posture est symptomatique d’un État qui n’a pas de souveraineté monétaire et qui fait face à une conjoncture économique difficile.
Dans de telles conditions, la promesse de “mobiliser des ressources domestiques” n’est pas un gage de souveraineté financière mais plutôt, comme dans la période coloniale, un symbole vivide de son absence.
Ultimement, la souveraineté financière, et donc la souveraineté politique, d’un État requiert a minima une banque centrale assurant son indépendance financière, notamment via le maintien de taux d’intérêt soutenables sur la dette souveraine en monnaie nationale, le développement d’un secteur bancaire et financier national et orienté vers la transformation économique et industrielle. Lisons à nouveau Wynne Godley :
“Le pouvoir d'émettre sa propre monnaie, de faire des tirages sur sa propre banque centrale, est l'élément principal qui définit l'indépendance nationale. Si un pays abandonne ou perd ce pouvoir, il acquiert le statut de collectivité locale ou de colonie. Les collectivités locales et les régions ne peuvent évidemment pas dévaluer. Mais elles perdent aussi le pouvoir de financer les déficits par la création monétaire, alors que les autres méthodes de financement sont soumises à la réglementation centrale. Elles ne peuvent pas non plus modifier les taux d'intérêt. Comme les autorités locales ne possèdent aucun des instruments de la politique macro-économique, leurs choix politiques se limitent à des questions relativement mineures - un peu plus d'éducation ici, un peu moins d'infrastructures là”. (Wynne Godley, Maastricht and all that, London Review of Books, 1992)
Au Sénégal, comme dans la plupart des pays africains, depuis la période coloniale jusqu’à présent, malgré la succession des régimes politiques et des plans de développement, les choix politiques se sont limités “à des questions relativement mineures”. Hélas, le plan de redressement, en dépit de ses bonnes intentions, n’y échappe pas, d’autant plus qu’il reste silencieux sur la manière dont la grave crise de la dette qui est déjà avec nous va être solutionnée. Un sujet que nous traiterons dans notre prochain article.
NDONGO SAMBA SYLLA Économiste, Directeur Afrique de l’International Development Economics Associates (IDEAs)
&
MAHAMADOU LAMINE SAGNA Enseignant-Chercheur, Worcester Polytechnic Institute, USA. Auteur de “Monnaie et Sociétés”, 2001.