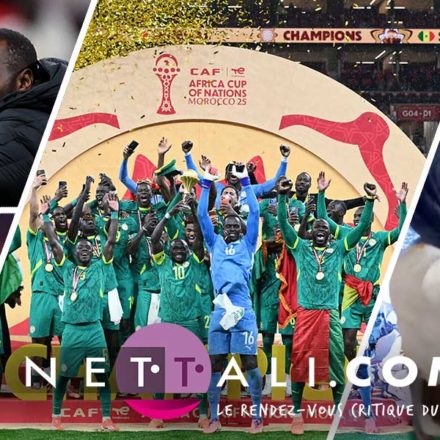CONTRIBUTION - L’histoire politique du monde, et particulièrement celle des mouvements de libération en Afrique et en Amérique latine, montre que tout leader issu d’une mobilisation populaire affronte un moment de vérité lorsqu’il accède au pouvoir. Ousmane Sonko, à sa manière, entre aujourd’hui dans ce cycle historique, celui où le rêve de justice et de souveraineté doit se confronter à la mécanique de l’État.
1. Nelson Mandela, de la ferveur à la réconciliation
Lorsque Mandela sort de prison en 1990, il incarne la lutte, la résistance, la dignité retrouvée du peuple noir sud-africain. Pourtant, à son arrivée au pouvoir en 1994, il choisit la voie du compromis plutôt que celle de la revanche. Il comprend que gouverner un pays fracturé, c’est éviter que la passion militante ne devienne un moteur de division. Son plus grand acte politique n’a pas été de prolonger la lutte, mais de la transformer en contrat social.
Mandela a réussi à transformer la colère en projet collectif. Sonko, dans un autre contexte, affronte le même défi, celui de convertir l’énergie de la rupture en force de reconstruction nationale.
2. Lula da Silva, de l’ouvrier au président bâtisseur
Au Brésil, Lula vient du peuple et des luttes syndicales. Lorsqu’il accède au pouvoir en 2003, les attentes sont immenses. Il doit sortir des millions de Brésiliens de la pauvreté. Sa réussite vient de sa capacité à institutionnaliser la solidarité, en créant des programmes comme Bolsa Família, sans renoncer à sa base populaire. Mais cela a exigé de lui des compromis économiques, des alliances avec des élites et des partis qu’il avait autrefois combattus.
Sonko pourrait être confronté à une épreuve similaire, faire des compromis sans compromettre ses principes, maintenir l’équilibre entre pragmatisme gouvernemental et fidélité à la vision initiale.
3. Thomas Sankara, la pureté révolutionnaire
Sankara représente la figure inverse : celle du refus du compromis. Il a voulu tout changer, tout de suite, les mentalités, l’économie, la souveraineté. Son intégrité était totale, mais son refus des ajustements politiques lui a valu l’isolement, puis la chute.
Sonko partage avec Sankara une même rhétorique de dignité africaine et de souveraineté populaire, mais il devra apprendre de ce précédent. La radicalité morale seule ne suffit pas à transformer durablement un système si elle n’est pas soutenue par des institutions solides et une stratégie d’ancrage.
4. Kwame Nkrumah ou la tragédie du fondateur
Premier président du Ghana indépendant, Nkrumah fut porté par la ferveur panafricaine. Mais l’usure du pouvoir, la centralisation excessive et la méfiance envers la contestation l’ont conduit à s’éloigner de sa base et à sombrer dans un autoritarisme d’État. Ce rappel historique met en garde contre une dérive fréquente. Lorsque la mobilisation populaire se transforme en légitimation du contrôle total. Sonko devra éviter ce piège en maintenant un espace de débat et de pluralisme au sein même de son mouvement.
5. L’épreuve sénégalaise, du cri à la construction
Le Sénégal est une nation qui a longtemps connu la stabilité institutionnelle, mais aussi une lente érosion de la confiance entre gouvernés et gouvernants. Surtout entre 2021 et 2024. La force de Sonko réside dans sa capacité à rendre audible le cri populaire, celui des jeunes sans emploi, des ruraux, des intellectuels en quête de sens et à réhabiliter la dignité comme valeur politique.
Mais sa réussite dépendra de sa capacité à inscrire cette énergie dans des structures solides : Réforme de l’administration, lutte réelle contre la corruption, redistribution équitable, autonomie économique. Là encore, le passage du charisme de la mobilisation à l’efficacité de la gouvernance est un test que peu de leaders ont réussi.
EN RÉSUMÉ
La mobilisation et la gouvernance sont les deux faces d’un même pouvoir. L’une donne l’âme, l’autre la structure. L’une élève, l’autre construit. Ousmane Sonko est aujourd’hui à cette croisée des chemins où la passion du peuple doit devenir projet d’État, et où la vision doit se muer en action. S’il réussit à maintenir le souffle de la mobilisation tout en construisant les fondations d’une gouvernance crédible, il pourra inscrire son nom parmi ceux qui ont su transformer la ferveur en refondation, et non la voir se dissoudre dans les lenteurs administratives ou les querelles internes. Mais s’il échoue à convertir le rêve en institutions, le risque est grand que la ferveur populaire devienne amertume, et que l’histoire le classe non parmi les bâtisseurs, mais parmi les espérances déçues.
Voilà #MaintenantVousSavez