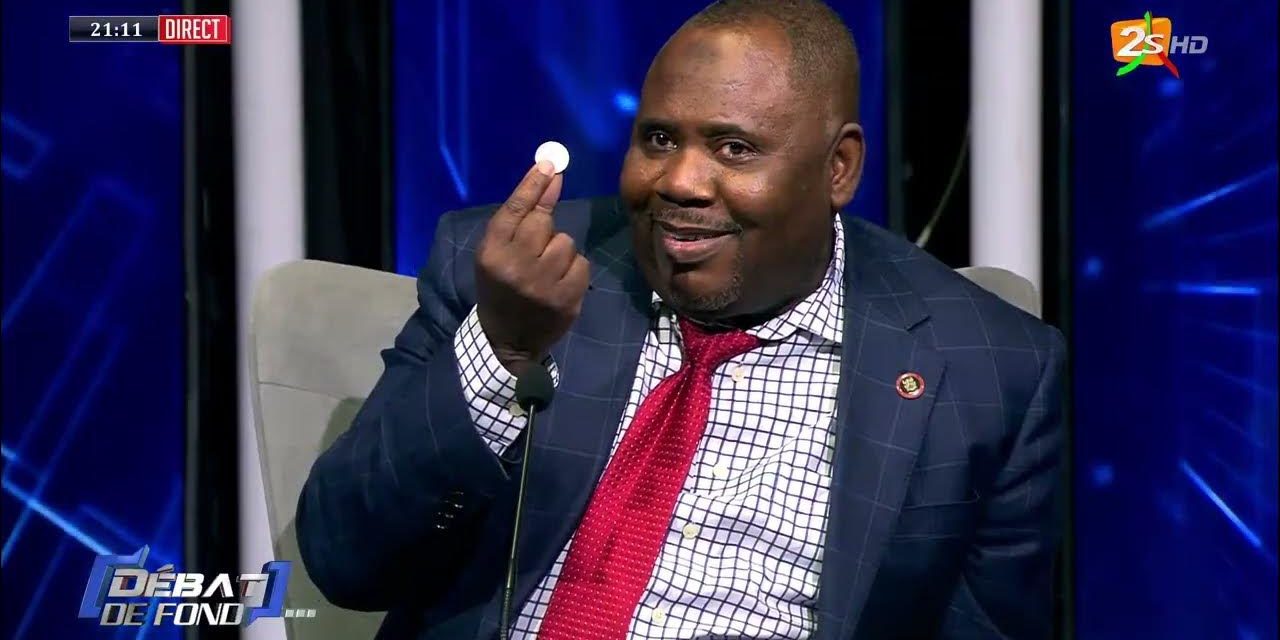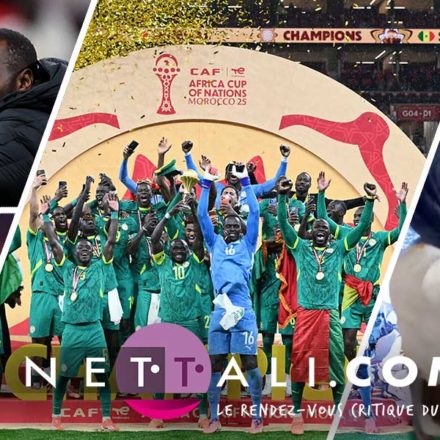CONTRIBUTION - Résumé Cet article analyse les limites d’une stratégie de développement fondée exclusivement sur la fiscalité au Sénégal, conformément aux recommandations récurrentes du Fonds monétaire international (FMI). À partir d’une approche théorique et empirique, il montre que la fiscalité, bien que nécessaire, ne constitue jamais le moteur initial du développement économique. Les expériences historiques des pays industrialisés démontrent que l’industrialisation a toujours reposé sur une combinaison entre création monétaire, investissement productif et consolidation fiscale.
Le Sénégal illustre un piège fiscal marqué par une économie informelle massive, une assiette limitée et une faible confiance citoyenne, rendant inefficace l’augmentation des impôts comme levier de croissance. L’analyse empirique (2011–2023) révèle que, malgré des réformes fiscales ayant permis une progression des recettes (de 16 % à près de 20 % du PIB), la dépendance à l’endettement extérieur reste forte, avec une dette dépassant 53 % du PIB en 2023, tandis que la croissance économique demeure insuffisamment transformatrice.
En s’appuyant sur les travaux de Kalecki, Lerner, North, Krugman et Stiglitz, l’article conclut que la fiscalité doit être articulée avec une politique monétaire souveraine et un programme ambitieux d’investissements productifs. Sans cette combinaison, le Sénégal restera prisonnier d’un modèle budgétaire contraint, incapable de soutenir une industrialisation durable et une véritable souveraineté économique.
Introduction
Depuis son indépendance, le Sénégal suit des trajectoires économiques largement influencées par les institutions financières internationales, au premier rang desquelles figure le Fonds monétaire international (FMI). Ces recommandations insistent, depuis plusieurs décennies, sur l’élargissement de l’assiette fiscale et le renforcement de la collecte des impôts comme leviers majeurs de développement. Si la fiscalité demeure un instrument essentiel de financement de l’État, elle ne peut à elle seule constituer la clé de la prospérité économique.
L’histoire économique comparée des pays aujourd’hui industrialisés montre que ceux-ci ont systématiquement combiné deux leviers complémentaires : la création monétaire (ou le crédit productif) et la fiscalité. Réduire la stratégie de développement du Sénégal à la seule mobilisation fiscale, comme le recommande le FMI, revient à ignorer les fondements mêmes de l’économie politique et les leçons des trajectoires historiques de développement.
I. Leçons historiques : le développement par le couple monnaie-fiscalité
Les expériences internationales montrent clairement que la fiscalité n’a jamais été le moteur initial du développement économique.
• En Europe et aux États-Unis, l’industrialisation a été financée prioritairement par le crédit bancaire, la dette publique et la dépense d’investissement.
• En Corée du Sud, l’État a dirigé les flux de crédit vers les conglomérats (chaebols), créant une base industrielle solide avant de consolider le système fiscal.
• En Chine, la Banque populaire de Chine a utilisé la création monétaire pour financer des infrastructures et des zones industrielles, soutenant ainsi une croissance rapide.
Ces expériences confirment l’analyse de Michał Kalecki (1971) : “pas de développement sans industrialisation, pas d’industrialisation sans investissement, et pas d’investissement sans création monétaire.”
Paul Krugman (1994) souligne également que la croissance repose sur la capacité de l’État à financer des investissements productifs de long terme, notamment dans les infrastructures, la recherche et l’éducation. L’impôt, en ce sens, ne crée pas directement de richesses, mais redistribue ce qui est déjà produit.
II. Le piège fiscal sénégalais
Le Sénégal illustre parfaitement ce que l’on peut appeler un “piège fiscal” :
1. Une économie informelle prépondérante, représentant près de 50 % du PIB, échappant en grande partie à l’impôt.
2. Une assiette fiscale limitée, concentrée sur un petit nombre d’entreprises formelles et sur la fiscalité indirecte, souvent régressive.
3. Un déficit de confiance entre l’État et les contribuables, alimenté par une faible perception de la redistribution et de la qualité des services publics.
Dans ce contexte, l’augmentation des impôts, telle que préconisée par le FMI, ne stimule pas la croissance. Elle se contente de prélèver sur une base économique fragile, accentuant parfois les inégalités et décourageant l’investissement privé.
Douglass North (1990) rappelle que la fiscalité ne peut jouer un rôle central que si elle s’inscrit dans des institutions solides et dans une dynamique de productivité croissante. Or, au Sénégal, l’impôt demeure davantage un outil de survie budgétaire qu’un instrument de transformation économique.
III. La création monétaire comme levier nécessaire
Contrairement aux approches restrictives du FMI, la création monétaire, bien encadrée, constitue un outil incontournable pour financer le développement.
1. Le financement des infrastructures stratégiques
Routes, énergie, numérique et ports constituent des investissements lourds et indispensables. Le Sénégal ne peut attendre la lente progression de ses recettes fiscales pour les financer.
2. Le soutien à l’industrialisation et à l’emploi
Les entreprises sénégalaises restent sous-capitalisées et vulnérables à la concurrence extérieure. Une politique de crédit productif permettrait de stimuler l’industrialisation, de renforcer l’emploi et d’accroître la valeur ajoutée locale.
3. La souveraineté économique
En l’absence d’un tel levier, le Sénégal se tourne vers l’endettement extérieur, souvent libellé en devises, accroissant sa dépendance et réduisant sa souveraineté budgétaire.
Abba Lerner (1944), avec sa théorie de la “finance fonctionnelle”, démontre que l’État doit orienter la création monétaire vers les secteurs productifs afin de stimuler durablement la croissance et les recettes fiscales futures.
IV. Les limites des recommandations du FMI
Le FMI privilégie une approche orthodoxe, centrée sur la discipline budgétaire et la mobilisation fiscale. Cette stratégie est problématique car : • Elle repose sur un modèle universel appliqué indistinctement, sans tenir compte des spécificités structurelles du Sénégal.
• Elle inverse la causalité : elle considère la fiscalité comme préalable au développement, alors qu’elle est la conséquence d’une base productive élargie.
• Elle entretient un cercle vicieux : fiscalité accrue → faible croissance → stagnation de l’assiette → nouveaux besoins fiscaux.
Joseph Stiglitz (2002) critique ces approches uniformes et plaide pour une combinaison de politiques monétaires actives, d’investissements publics ciblés et de réformes institutionnelles.
V. Vers une stratégie sénégalaise de développement
Pour dépasser ces blocages, le Sénégal doit construire une stratégie économique fondée sur trois piliers complémentaires :
1. Souveraineté monétaire partielle ou totale : permettre à la Banque centrale (dans le cadre de l’UEMOA ou via des réformes) de soutenir directement le financement d’investissements stratégiques.
2. Investissement massif dans les secteurs productifs : agriculture modernisée, industrie locale, énergie, infrastructures et numérique.
3. Fiscalité équitable et consolidante : élargir l’assiette progressivement, en lien avec la croissance économique, et améliorer la redistribution pour renforcer la confiance sociale.
VI. Analyse empirique : le Sénégal (2011–2023)
Entre 2011 et 2023, le Sénégal a connu une légère progression de ses recettes fiscales, passées d’environ 16 % du PIB à près de 20 %, grâce notamment à des réformes administratives qui ont rapporté près de 3,3 points de PIB supplémentaires. Toutefois, cette amélioration reste insuffisante pour financer les besoins massifs en infrastructures et en industrialisation, ce qui a conduit l’État à recourir largement à l’endettement extérieur, faisant grimper la dette publique à plus de 53 % du PIB en 2023, avec des pics supérieurs à 70 % selon certaines estimations liées au Plan Sénégal Émergent (TER, énergie, infrastructures). La croissance, en moyenne proche de 5 % sur la décennie, reste positive mais n’a pas permis une transformation structurelle de l’économie ni une réduction significative de l’informalité et du chômage. Ces données confirment que la seule stratégie fiscale, même renforcée, ne peut constituer le moteur du développement sénégalais sans le soutien d’une politique monétaire active et d’investissements productifs massifs.
Conclusion
Le cas sénégalais démontre les limites d’une stratégie fondée uniquement sur la fiscalité. Comme l’enseigne l’histoire économique, la fiscalité ne précède pas le développement : elle en découle. Sans création monétaire et sans investissement massif dans les secteurs productifs, le Sénégal restera prisonnier d’une économie fragile, dépendante de l’endettement extérieur et soumise aux recommandations des institutions financières internationales. Pas de développement sans industrialisation, pas d’industrialisation sans investissement, et pas d’investissement sans création monétaire. C’est seulement en combinant fiscalité, souveraineté monétaire et investissements productifs que le Sénégal pourra bâtir un développement durable et autonome.
DR SEYDOU BOCOUM LAREM