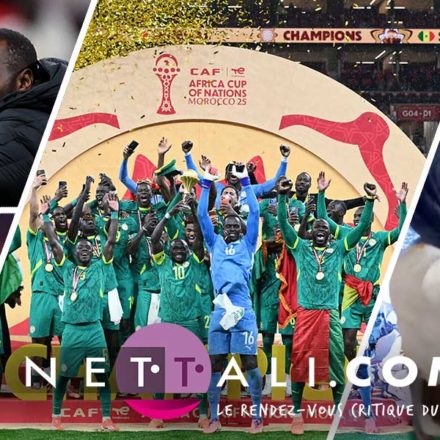NETTALI.COM - Sous Senghor, Diouf et Wade, la justice a souvent été critiquée. Elle a continué de l’être sous le régime de Macky Sall et celui du président Diomaye Faye. Mais jamais des critiques n'ont jamais été aussi virulentes. Ce qui veut dire que la question de l’indépendance de la justice s'est toujours posée. Il est dès lors de se demander si la justice est réellement responsable de cet état de fait ou non ? Ou s'il n’a-t-il pas toujours été question, depuis Senghor jusqu’à nos jours, d'une volonté de la soumettre et de l’orienter dans le sens que souhaitent les politiques, qu’ils soient de l’opposition ou du pouvoir. Ce qui est en tout cas à relever, est que ce déficit d’indépendance est particulièrement dénoncé dès lors qu’il est question de contentieux politique ou d’affaires connexes à la politique.
Il existe en effet aujourd’hui, une certaine propension à mettre la pression sur la justice, notamment dans le cadre de la reddition des comptes, où les échos qui nous parviennent des réseaux sociaux et de déclarations d’autorités politiques, tendent à considérer le rythme de traitement des dossiers, lent. Le premier ministre, Ousmane Sonko ne cesse par exemple de réclamer la célérité dans le traitement des dossiers, mais aussi d’adresser des critiques acerbes contre la justice. La reddition des comptes et ses revers judiciaires sont passés par là : rejet de son rabat d’arrêt dans l’affaire de diffamation l’opposant à Mame Mbaye Niang ; l’alinéa 2 de l’article 56, l’alinéa 6 de l’article 60, l’alinéa 6 de l’article 111 et l’article 134 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, jugés inconstitutionnels au mois de juillet dernier ; et la loi interprétative déposée par Amadou Ba de Pastef qui n'a eu l'effet escompté.
Un autre fait à déplorer d'ailleurs, est que Waly Diouf Bodiang, proche collaborateur d’Ousmane Sonko et directeur général du Port autonome de Dakar, ne rate jamais l’occasion de s’en prendre à la justice. Le dimanche 10 Août, il a encore pris la parole, à travers un message publié sur ses réseaux sociaux et dans lequel, il a accusé le Conseil constitutionnel de représenter une menace pour le projet politique en cours : "Le Conseil constitutionnel est une bombe à retardement minutée et posée au siège du projet ", a-t-il écrit sur Facebook. Un argument pour le moins intolérable que tout républicain devrait se garder d’émettre. Un sacré numéro, ce membre de Pastef ! Il devrait plutôt se mettre au travail plutôt que de passer son temps à songer à rivaliser de propos désagréables.
La question est surtout de se demander, au nom de quoi ceux qui s’en prennent à la justice, croient-ils qu’elle devrait forcément leur donner raison à partir du moment où ils vont la solliciter ? Parce qu’ils sont au pouvoir ? A partir du moment où l’on décide de s’adresser à la justice, cela ne signifie-t-il pas qu’on lui fait confiance ? Ils devraient s’évertuer à être fair-play.
De même, l’on peut leur demander en quoi les dossiers politico-judiciaires, devraient nécessiter un traitement plus diligent que ceux des prévenus qui attendent leur jugement depuis des années ? Ceux qui mettent la pression sur la justice, ne sont, à la vérité, pour la plupart, guidés que par un souci de règlements de comptes fondé sur leur subjectivité et un esprit partisan qui les empêchent d’avoir du recul et de la retenue. Ils en sont même à penser que tous ceux dont la tête ne revient pas à certains militants du Pastef ainsi que les actes posés de par le passé, doivent goutter à la prison ! Ils oublient sans doute qu’ils ne sont ni membres d’un quelconque corps de contrôle, ni juges et qu’ils bafouent d’emblée la présomption d’innocence qui fait de tout prévenu, un présumé innocent jusqu’à la preuve du contraire. Sans doute ignorent-ils tout de la procédure pénale, de l’engorgement des cabinets d’instruction, du dénuement en moyens matériels et humains de la justice et le fait que le juge qui rend son jugement, le fait sur la base de textes de lois et non sur celle du bon vouloir de ceux qui mettent la pression sur elle.
Il ne s’agit point d’épargner des coupables, loin de là. Mais ceux-là doivent laisser à ceux dont c’est le métier, le soin de juger sereinement, mais aussi de tenir compte du principe d’égalité des citoyens devant la justice.
Bref des pressions et des griefs contre la justice qui ne cessent de se multiplier, au point même que le président Bassirou Diomaye, lors d’une de ses interviews à la veille de la fête d’indépendance, avait dû s’y mettre lui aussi, demandant de mettre la pression sur la justice. Ce n’est que récemment, dans l’une de ses sorties, qu’il a dû se résoudre à réclamer la sérénité dans l’exercice de la justice.
L’UMS fixe les lignes rouges
Ousmane Diagne, le ministre de la justice, lors de l’Assemblée générale de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) a ainsi rappelé que « l’activité judiciaire, comme toute œuvre humaine, n’est pas parfaite et ne saurait échapper à la critique ». Mais, il a toutefois estimé que celle-ci ne doit pas fragiliser la justice, soulignant au passage, que le législateur prévoit des voies de recours pour contester les décisions, invitant chacun à éviter tout discours destructeur.
Lors de l’Assemblée générale de la structure, le président sortant, Ousmane Chimère Diouf a donné les raisons de ce silence dans certaines situations. "La parole publique du magistrat, qu’elle soit orale ou écrite, doit se faire dans le respect des règles prévues par nos statuts. Le respect de ces principes justifie le silence du bureau, après le vote par l’Assemblée nationale de la loi portant règlement intérieur qui, dans une de ses dispositions, a prévu la possibilité pour le Parlement de convoquer les magistrats”. En fait, estime Diouf, le magistrat doit, en toutes circonstances, éviter de verser dans le populisme. "Les principes gouvernant notre profession ne sont nullement conciliables avec le populisme”, a-t-il affirmé, invitant ses collègues à plus de prudence dans leur intervention dans l’espace public. "En effet, le magistrat ne peut alimenter le débat public par des prises de position contraires à son serment et doit attendre d’être saisi pour rendre sa décision. Il doit également éviter tout propos ou comportement qui pourrait être considéré comme irrespectueux envers les justiciables et faire preuve de retenue dans ses commentaires sur les réseaux sociaux", requiert le ci-devant président de l’UMS. C’est tout le contraire d’ailleurs avec le politique qui, dans ses sorties médiatiques, est surtout dans la quête d’influence, de convaincre l’opinion.
Chimère Diouf avertit : "Dame Justice n’est ni avec ni contre personne. Elle ne peut donc jouer un rôle actif dans un permanent jeu politique fait d’attaques, d’instabilité, de polémiques, d’intérêts du moment à gérer en évitant en sa qualité d’arbitre, comme le rappelait notre éminent doyen Kéba Mbaye, de descendre dans l’arène pour y prendre des coups."
Le magistrat, selon lui, doit rester insensible à ces attaques, puisqu’en tant qu’arbitre, il ne saurait descendre dans l’arène pour en découdre. Même si la tâche s’avère difficile, puisque ces attaques et invectives des politiques peuvent avoir un impact sur la perception de la justice.
Pour l’UMS, les critiques sont certes normales quand elles sont objectives, mais dans la plupart des cas, elles sont subjectives et injustifiées. "Nous sommes conscients que le peuple au nom de qui justice est rendue a parfaitement le droit de porter un regard critique sur la bonne marche de celle-ci, surtout que c’est lui qui subit les conséquences de l’application rigoureuse de la loi. Critique ne signifie, cependant pas discrédit et la frontière doit être clairement définie pour éviter tout dérapage", lance le président Chimère, qui rappelle que "le système judiciaire est lui-même basé sur la critique, puisque les voies de recours ont été créées pour permettre au plaideur non satisfait d’une décision de saisir la juridiction supérieure".
Un pouvoir limité du corps judiciaire
Et pourtant, le corps judiciaire, contrairement à ce que pensent tous ceux-là qui tentent d’exercer une pression sur elle, ne détient pas tant de pouvoirs que cela. Le pouvoir est à la vérité entre les mains de l’exécutif. Et le président de la cour suprême l’avait d’ailleurs réaffirmé, lors de la rentrée des cours et tribunaux. "La hiérarchie judiciaire n’a en effet aucun pouvoir juridique de proposition de nomination aux emplois judiciaires établis par les statuts sociaux des magistrats. Elle ne peut, en matière pénale, poursuivre un magistrat sans y être autorisé par le ministre de la justice. Enfin, la saisine du conseil de discipline des magistrats appartient exclusivement au ministre de la justice. Il s’avère ainsi qu’aucun levier important, ni aucune initiative permettant de mettre fin à un dysfonctionnement du système judiciaire, n’est confié au pouvoir judiciaire, aux magistrats. (…) Dans ces conditions, en cas de difficulté majeure, les regards doivent se tourner vers le ou les maîtres du jeu pour situer les responsabilités. En tout état de cause, une fois nommé, le magistrat ne doit obéir qu’à la loi et à sa conscience en conformité à son serment… ", avait ainsi lancé avec calme celui qui trône au-dessus de la magistrature.
L’indépendance de la justice, c’est ce pour quoi le magistrat Souleymane Téliko a passé le plus clair de son mandat de 4 ans à la tête de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), à plaider. Alors qu’il était président sortant, lors d’une assemblée générale de l’Union de l’UMS, tenue le samedi 7 août 2021, celui-ci dans son discours d’adieu, n’avait pas hésité à donner l’exemple du parquet, avec le ministre de la justice qui a la possibilité de s’immiscer dans les affaires judiciaires, estimant qu’ " il est une autorité judiciaire qui a des attributions juridictionnelles, qui peut ordonner des arrestations, requérir le mandat de dépôt, exercer des voies de recours qui maintiennent la personne en détention ". "Quand vous mettez une telle autorité sous la subordination de l’exécutif, indirectement vous donnez à l’exécutif la possibilité d’avoir une influence sur le traitement des affaires judiciaires ", avait-il expliqué. Avant d’ajouter : "donc aujourd’hui, le ministre peut, par instruction écrite, demander au parquet de requérir dans tel ou tel sens. Cela est une entorse aux principes de la séparation des pouvoirs ".
Pour lui, le ministre de la Justice devrait se contenter de donner des circulaires pour tracer les grandes lignes de la politique pénale et laisser à chaque procureur le soin de décider librement du traitement des affaires judiciaires, conformément aux attributions que lui confère le Code de procédure pénale. Tout cela supposait, selon lui, outre la réforme du Code de procédure pénale, que l’exécutif ne puisse plus siéger au sein du Conseil supérieur de la magistrature.
Le domaine le plus illustratif de cette immixtion de l’exécutif dans le travail de la justice, est celui des contentieux dans lesquels, sont impliqués des hommes politiques. Et il est pourtant de loin, le plus faible ! En effet, entre les deux dossiers d’Ousmane Sonko pour diffamation et viol, celui de Karim Wade avec la Cour de répression de l’enrichissement illicite, de Khalifa Sall avec la caisse d’avance de la Mairie de Dakar, ou encore celui des chantiers de Thiès avec Idrissa Seck, les dossiers non aboutis contre Macky Sall dans une accusation de blanchiment de capitaux qui s’est arrêté à la sûreté urbaine, les emprisonnements de Me Abdoulaye Wade et l’épisode Mamadou Dia sous Senghor, les exemples foisonnent pour montrer que cette tradition de dossiers qualifiés de politico-judiciaires, sont une bonne vieille tradition qui s’est durablement installée sous nos cieux.
Curieux système que le nôtre. Et même si l’on peut continuer à avoir foi à la volonté du sage président Diomaye de « libérer » la justice, ainsi qu’il le reconnaît et le promet, il y a de quoi réformer rapidement cette justice.
La réforme de la justice : une demande sociale
La réforme de la justice est une demande sociale. C'est sûr. Que le président de la république veuille se maintenir ou pas dans le Conseil supérieur de la magistrature, notamment dans un contexte où les conclusions des Assises de la justice sont déposées sur sa table, son maintient ne gêne nullement l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) qui avait émis un avis défavorable à la sortie du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature. Et sur cette question d'ailleurs, l’Exécutif semblait un peu plus coopératif. Mais l'UMS a toutefois, dans le même temps, réaffirmé par la voix d’Ousmane Chimère Diouf, lors de son Assemblée générale, son opposition à l’ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à des personnalités non appartenant au corps des magistrats. Une position que les magistrats avaient déjà donné, selon lui, sur la question, l’année dernière, lors de leur précédente assemblée générale et dans d’autres circonstances.
Toujours est-il qu’il reste impérieux de revisiter beaucoup d’aspects liés à la justice, notamment la procédure pénale, le fait de rendre aux magistrats le pouvoir disciplinaire et de nomination sur leurs pairs, tout en maintenant le pouvoir de signer les décrets de nomination et de radiation du président de la république.
De même est attendue la révision des textes (code pénal, code de procédure pénale, statut des magistrats, loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, loi sur la Cour suprême, loi sur le Conseil constitutionnel, code de la famille…). Il ne serait pas par exemple inutile, d’introduire cette bien vieille doléance que l’introduction d’un juge des libertés et de la détention afin qu’il devienne celui qui décide du sort des prévenus et non le procureur de la république qui ne doit plus être juge et partie aux procès.
Mais ce sont surtout les dispositions liberticides (article 56 à 100 du Code pénal et l’article 139 du Code de procédure pénal) ainsi que l’article 254 (offense au chef de l’Etat) qui ne semblent être guidées que par une seule volonté, celle de protéger le président de la république ou son gouvernement, qui sont à scruter à la loupe. Des lois d’une autre époque ! Surtout que les poursuites récentes du parquet vont de plus en plus dans le sens de viser des délits d’offense à " des personnes délégataires de pouvoirs du président de la république " prévus à l’alinéa 2 de l’article 254 du Code pénal. De quoi se poser davantage de questions sur l’opportunité de telles poursuites, cette dernière disposition devant être subordonnée à l’existence d’un décret présidentiel confiant tout ou partie des prérogatives du chef de l’Etat au Premier ministre ou à certains ministres. Décret que personne n’a jusqu'ici vu !!!
Mais au-delà, l’on peut se demander comment par exemple occulter l’équation de la détention préventive ? Les tribunaux sont certes engorgés et le nombre de magistrats insuffisant. Mais ne doit-on pas garder à l’esprit, à défaut de bannir les mandats de dépôts systématiques, de réparer ce qui peut l’être. Par exemple, dès lors qu’une peine prononcée contre un détenu, est inférieure au temps passé en détention. La récente détention préventive de Moustapha Diakhaté qui aura passé 51 jours en prison, sans oublier celle de Bachir Fofana et leur condamnation respective qui a suivi, à 15 jours de prison fermes et à une peine avec sursis, doivent nous pousser à nous interroger sur la question de la détention préventive.
La question est aussi de savoir, si en fin de compte, il ne faudrait pas assouplir le système d’indemnisation des victimes de la justice et l’étendre à ceux-là à qui l’on a fait perdre leur temps en détention et qui se retrouvent avec des peines largement moindres. C’est un défaut même de la justice qu'elle-même doit réparer, si elle veut rester juste.
En somme, autant d’équations pour une justice qui se veut juste, surtout que ce régime a fini depuis belle lurette, de chanter le vent de la rupture sur tous les toits.
Comme quoi la communication ne doit pas relever que du fantasme. C'est pour dire que les actions vertueuses sont la forme de communication la plus efficace.