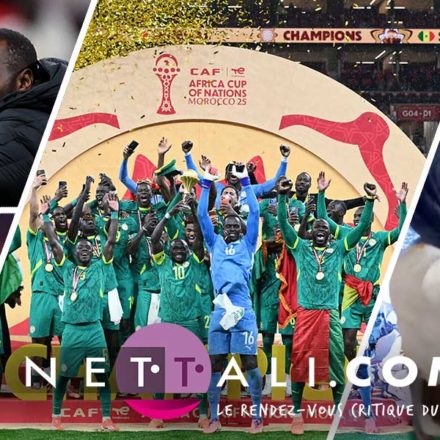NETTALI.COM - La Journée mondiale de lutte contre les hépatites a été célébrée hier. Une occasion pour le ministère de la Santé et de l’Action sociale de rappeler quelques notions clés.
L’ hépatite virale, selon une note du ministère de la Santé et de l’Action sociale, constitue un problème mondial de santé publique, comparable à celui posé par d’autres grandes maladies transmissibles comme le VIH, la tuberculose ou le paludisme. Le Sénégal paie un lourd tribut aux hépatites virales.
Selon des études, en 2018, le nombre de Sénégalais porteurs chroniques d’hépatite B était estimé à 1,5 million et celui de porteurs chroniques d’hépatite C à 300 000. Ils transmettent ces virus pendant des années avant d’évoluer eux-mêmes vers la cirrhose et le cancer du foie. Au Sénégal, des études récentes ont permis d’évaluer le fardeau des hépatites virales B et C avec des taux de prévalence de 7 % pour l’HVB et de 2 % pour l’HVC.
Face à ces réalités épidémiologiques, renseigne la même source, le Sénégal a pris conscience, depuis les années 1980, du problème sanitaire représenté par les hépatites virales et s’est mobilisé très tôt pour les combattre par des actions pertinentes et soutenues aux niveaux national et régional. Il s’agit notamment de la création de l’Initiative panafricaine de lutte contre les hépatites (IPLH) sous le leadership du Sénégal ; de la mise en place, depuis 1999, d’un programme pionnier en Afrique : le Programme national de lutte contre les hépatites (PNLH) ; de la vaccination universelle des nouveau-nés et des nourrissons, effective depuis 1999 ; de la forte contribution de notre pays à la mise au point du vaccin contre l’hépatite B ; du dépistage systématique des donneurs de sang pour les virus de l’hépatite B depuis 1982 et de l’hépatite C depuis 2010 ; des recherches de haute portée démontrant la filiation hépatite–cirrhose– cancer du foie ; de la forte subvention de l’État du Sénégal pour le traitement de référence de l’hépatite B avec le Ténofovir ; et de l’élaboration, en 2024, d’un plan stratégique national intégré TB, IST/VIH, hépatites.
“Les progrès notés dans la prévention, à savoir l’introduction du vaccin à la naissance, la systématisation du dépistage chez les femmes enceintes, les donneurs de sang et les patients vivant avec le VIH, ont permis de faire baisser la prévalence de l’hépatite B de 11 % à 7 %. La mise sous traitement des patients éligibles, à travers tout le territoire national, a aidé à ralentir la progression de la maladie vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Le Programme national de lutte contre les hépatites est en train de mener des stratégies innovantes dans le cadre de la formation, du dépistage et de la prise en charge des prestataires de santé, des forces de défense et de sécurité, et des étudiants en santé. La lutte ne peut être gagnée que par la participation de toute la population pour une meilleure appropriation des stratégies de lutte contre les hépatites. C’est l’occasion de saluer les efforts faits par l’association Saafara Hépatite qui, depuis 2011, mène des campagnes de sensibilisation et d’accompagnement psychosocial et financier auprès des patients infectés par le virus”, a renseigné le document.
Il a ajouté que la prise en charge des patients reste un défi majeur pour le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Même si le traitement de l’hépatite B est subventionné à 5 000 F CFA par mois, le bilan de préinclusion et de suivi reste onéreux. L’optimisation des appareils GeneXpert disponibles à travers tout le pays permettrait de réduire le coût du bilan biologique et virologique.
Des efforts considérables sont également attendus pour prendre en charge les quelques patients infectés par les virus de l’hépatite C et Delta. “La contribution de toutes les parties prenantes (gouvernement, société civile, communauté, secteur privé, partenaires techniques et financiers…) faciliterait une lutte plus efficace contre cette maladie aux complications désastreuses. Il est important d’insister sur le dépistage précoce, la vaccination, la prise en charge adéquate et le respect des mesures de protection contre une contamination qui peut être materno- foetale, sanguine, sexuelle ou liée aux liquides biologiques”, a conclu le document.