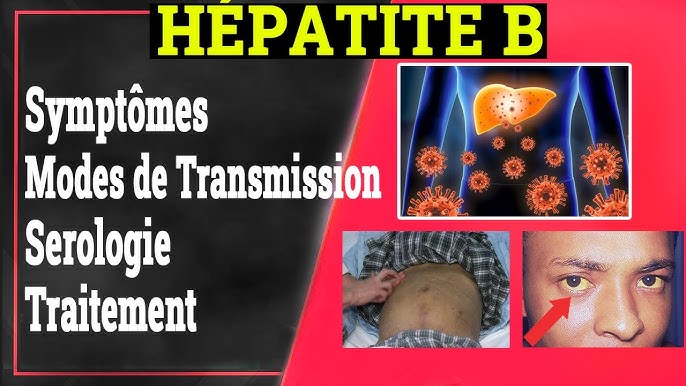NETTALI.COM - Le Sénégal a réduit de manière significative la prévalence de l’hépatite B, grâce à un programme pionnier mis en place dès 1998. Toutefois, la maladie reste un problème de santé publique, en raison de son évolution silencieuse et de son potentiel létal.
L’hépatite B continue d’interpeller les autorités sanitaires sénégalaises. Selon le Professeur Aminata Sall Diallo, coordonnatrice du Programme national de lutte contre l’hépatite, la situation du pays s’est nettement améliorée depuis la mise en place de ce dispositif, il y a plus de vingt ans.
« Le Sénégal a mis en place, dès 1998, le programme national de lutte contre l’hépatite, une première en Afrique. À cette époque, la prévalence des porteurs chroniques de l’hépatite B était estimée à 17 % de la population nationale, contre 6,3 % en 2025 », a-t-elle rappelé dans un entretien accordé à PressAfrik. Cette réduction traduit des avancées considérables, même si le taux actuel demeure préoccupant pour la santé publique.
Le Professeur Diallo a souligné que l’hépatite peut être provoquée par des bactéries, des virus, des parasites ou encore certains médicaments. Mais ses équipes se concentrent surtout sur l’hépatite B, en raison de son potentiel évolutif vers des complications graves comme la cirrhose ou le cancer du foie.
Une maladie silencieuse et difficile à dépister
Sur le plan clinique, l’hépatite B se distingue par sa discrétion. « 90 % des cas n’expriment pas de signes », a précisé la spécialiste. Cette évolution silencieuse fait que la maladie n’est souvent détectée qu’après plusieurs années, parfois au stade de complications avancées.
Pour les 10 % de cas symptomatiques, les signes demeurent généraux : ictère (jaunissement de la peau et des yeux), fatigue intense, perte d’appétit ou troubles intestinaux. Des manifestations qui, isolées, peuvent être confondues avec d’autres affections, compliquant ainsi le diagnostic.
Concernant le taux de mortalité lié à l’hépatite B au Sénégal, le Professeur Diallo a regretté l’absence d’outils de suivi fiables. « Nous ne disposons que des données hospitalières, alors que beaucoup de personnes atteintes d’hépatite ou de cancer du foie meurent à domicile », a-t-elle expliqué. Cette lacune complique l’évaluation réelle de l’impact de la maladie dans le pays.